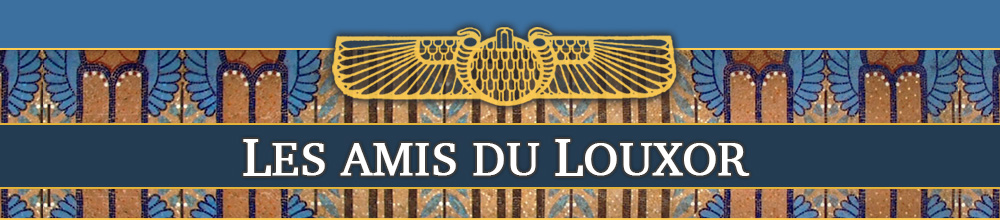Le Louxor-Palais du cinéma, par les Amis du Louxor et l’architecte Philippe Pumain, a été publié en juin 2013 par les éditions AAM.
I. Égyptomanie et goût de l’Égypte :
Marie-Jeanne Dumont et Rodolphe Hammadi, Paris Arabesques, Architectures et décors arabes et orientalisants à Paris, Paris, éd. Koehler/IMA/CNMH, 1988.
Jean-Marcel Humbert (dir.), Art déco – Egyptomanie, Textes de Mathias Auclair, Jean-Luc Bovot, Emmanuel Bréon, Hubert Cavaniol, Isabelle Conte, Maurice Culot, Daniel Lançon, Claire Maingon, Laurence Mouillefarine, William Pesson, Eugène Warmenbol. Editions Norma, Paris, 2022, 304 pages, 320 illustrations,
Jean-Marcel Humbert, Égyptomania, la collection de Jean-Marcel Humbert, édition Libel, Lyon, novembre 2022
Jean-Marcel Humbert, « Les monuments égyptiens et égyptisants de Paris », dans Bulletin de la Société française d’égyptologie, n° 62, octobre 1971, p. 9-29. [Louxor p. 27]
Jean-Marcel Humbert, L’égyptomanie dans l’art occidental, Paris, éd. ACR, 1989. [Louxor p. 82, 86 et 88].
Jean-Marcel Humbert, Egyptomania, l’Égypte dans l’art occidental, 1730-1930, catalogue d’exposition (musée du Louvre), coaut. Michael Pantazzi et Christiane Ziegler, Paris, éd. RMN, 1994.
Jean-Marcel Humbert, L’Égypte à Paris, Paris, éd. AAVP 1998 [Louxor p. 168 et 171].
Jean-Marcel Humbert, Rêve d’Égypte, l’architecture égyptisante vue par trois photographes, catalogue d’exposition (Mona Bismarck Foundation), Paris, éd. Mona Bismarck, 1998. [photo du Louxor par François-Xavier Bouchart, p. 64]
Jean-Marcel Humbert (dir.), Égypte-France, dialogues de deux cultures, Paris, éd. Paris-Musées/Gallimard, 1998 (Louxor p. 142), article repris dans repris dans Égyptomanie, la passion de l’Égypte, « Les expositions de L’Œil », hors-série, janvier 1998.[Louxor P. 14 et 40]
Jean-Marcel Humbert, « Introduction : an architecture between dream and meaning », dans Jean-Marcel Humbert et Clifford Price (dir.), Imhotep Today, egyptianizing architecture, actes du colloque Encounters with Egypt (Londres, décembre 2000), coaut. Clifford Price, Londres, éd. UCL Press, 2003, p. 1-24.
Robert Solé, L’Égypte, passion française, Paris, éd. Du Seuil, 1997.
II. Salles de cinéma : architecture et industrie
E. Vergnes, « L’architecture cinématographique », La Construction Moderne, 1er janvier 1922.
La Construction Moderne, 26 mars 1922. [Louxor, planches 101-102]
Francis Lacloche, Architectures de Cinémas, Editions du Moniteur, coll. Architecture «Les Bâtiments», Paris, 1981. [Louxor p 112-113]
Paris Grand Ecran, Splendeurs des salles obscures, 1895-1945, Paris-musées, 1994,
ouvrage coordonné par Renée Davray-Piekolek, conservateur au musée Carnavalet.
Virginie Champion, Bertrand Lemoine, Claude Terreaux, Les Cinémas de Paris 1945-1995, Délégation à l’Action Artistique de la Ville de Paris, 1995. [Louxor p.46 et 97. Photo p. 191]
Jean-Jacques Meusy, Paris Palaces ou le temps des cinémas (1894-1918), Paris, CNRS Editions, 1995.
Joëlle Farchy, « Le réveil de la Belle au Bois Dormant », catalogue de l’exposition Pathé, Premier Empire du cinéma, Editions Centre Pompidou, 1995. [Louxor p. 350]
Marc-Antoine Robert, « La naissance d’un grand circuit », catalogue de l’exposition Pathé, Premier Empire du cinéma, Editions Centre Pompidou, 1995. [Louxor p.280]
Christian-Marc Bosseno, La prochaine séance, les Français et leurs cinés, Découvertes Gallimard, 1996 [Louxor p. 49]
N.T. Binh, avec la collaboration de Franck Garbaz, Paris au cinéma, La vie rêvée de la capitale de Méliès à Amélie Poulain, Parigramme, 2005.
Les cinémas du 10e, Bulletin n° 5/2006 d’Histoire et Vies du 10e. [ Louxor : « Le Louxor : faste, déclin et renaissance ? » p. 48-60]
Jean-Jacques Meusy, Cinémas de France, 1894-1918. Une histoire en images, Arcadia Editions, 2009.
Stéphane Delorme, « Le cinéma à l’heure égyptienne », Cahiers du cinéma, juillet-août 2010, p. 87-93. (article bien documenté et bien illustré sur les salles de cinéma à l’égyptienne, dont le Louxor).
1913-2013, Un siècle de Monuments historiques, septembre 2013, Editions du patrimoine. (Ouvrage édité à l’occasion du centenaire de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et présenté sous sous forme d’éphéméride : un immeuble par année. L’année 1981 est illustrée par le Louxor-Palais du Cinéma.)
Lieux de spectacle et vie artistique de Paris, de Jacques Barozzi et Bernard Ladoux, Les essentiels du patrimoine, éditions Massin, 2013, page 114.
Le vieux Montmartre, bulletin n° 83, décembre 2013, « Le Louxor, un exceptionnel cinéma de quartier » par Jean-Marcel Humbert.
Raymond Delambre, Le cinéma sur les cimaises, éditions du Cerf, 2013. (Le chapitre 6, dédié au Louxor, est largement fondé sur un article de Stéphane Delorme paru dans les Cahiers du cinéma, et sur une discussion avec l’architecte Philippe Pumain et le directeur de la Mission cinéma, Michel Gomez. On regrettera certaines erreurs de l’auteur, notamment au sujet des mosaïques Art déco, œuvres de Gentil et Bourdet, attribuées au peintre des décors intérieurs dont le nom, Amédée Tiberti, est de surcroît écorché en Tiberi).
Ávila Gómez, Andrés « Las salas de cine diseñadas por las figuras de las vanguardias europeas. Aproximación a los orígenes de una tipología arquitectónica moderna », Revista de Arquitectura, vol. 15, enero-diciembre, 2013, pp. 84-101, Universidad Católica de Colombia, Bogotá. (Article sur l’architecture des salles de cinémas dans le monde ; une page est consacrée au Louxor.)
Simon Texier, Art Déco, collection Architecture et Patrimoine, Editions Ouest-France, Lille-Rennes 2015, 48 pages, p. 25. (Une erreur à rectifier : Amédée Tiberti est l’auteur des décors peints de l’intérieur et non des mosaïques, dessinées par Henry Zipcy et œuvre des mosaïstes Gentil et Bourdet).
Jean-Jacques Meusy, Écrans français de l’entre-deux guerres, Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 2017 (deux volumes : I. L’Apogée de « l’Art muet ». Format 21×27, 355 pages, 403 illustrations, II. Les années sonores et parlantes. Format 21×27, 260 pages, 219 illustrations).
Dominique Camus, photos Fred Aufray et Thierry Prat, Paris Décors, Art nouveau – Art Déco, édition revue et augmentée, Christine Bonneton éditeur, 2019. (p. 174-175)
Lesley Cook, Kanui & Lula with Joe Puni and friends, GrassSkirt 2022, 58 pages, nombreuses illustrations. Livre accompagné d’un CD. Les pages 19 et 22 rappellent que Kanui et Lula, musiciens et danseurs hawaïens, se produisirent sur la scène du Louxor en 1922.
III. Quartier Barbès et son environnement
Pascal Etienne, Le Faubourg Poissonnière, DAAVP, Paris, 1986. [ Jardins du Delta p. 257].
Marc Breitman, Maurice Culot, La Goutte d’Or – Faubourg de Paris, AAM-Hazan, Bruxelles-Paris, 1988.
Louis Chevalier, Les ruines de Subure. Montmartre de 1939 aux années quatre-vingts, Robert Laffont, 1985.
Alain Rustenholz, Paris ouvrier. Des sublimes aux camarades, Parigramme, 2003.
Jocelyne Van Deputte, Vie et Histoire du IXe arrondissement, Hervas, 1986.
Laure Beaumont-Maillet, Vie et Histoire du Xe arrondissement, Hervas,1988.
Pierre de Lagarde et Alfred Fierro, Vie et Histoire du XVIIIe arrondissement, Hervas,1988.
Edmond Ronzevalle, Paris 10e. Histoire, monuments et culture, Martelle, 1993.
Eric Hazan, L’invention de Paris, Seuil, 2002.
Thomas Clerc, Paris, musée du XXIe siècle. Le dixième arrondissement, Gallimard, «L’Arbalète » 2007.
Histoire et Vies du 10e, Paris 10e arrondissement, 1900-1840, Mémoire des Rues, Parimagine, 2007.
Geneviève Fraisse, « Barbès-la-Goutte d’Or », Les révoltes logiques, n° 12, 1980, p. 62-69.
IV. Le Louxor dans les romans
Daniel Crozes, L’Alouette, Éditions du Rouergue, 2004, p. 32 et 106-107.
Jakuta Alikavazovic, Le Londres-Louxor, Éditions de l’Olivier, 2010. (Le Londres-Louxor, ce cinéma fictif est librement inspiré du Louxor-Palais du Cinéma de Barbès.)